Arts, politique et [cultures minoritaires, institution, éducation populaire]
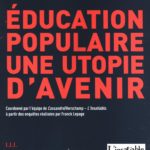
Éducation Populaire une utopie d’avenir
18.00€
Ajouter au panier

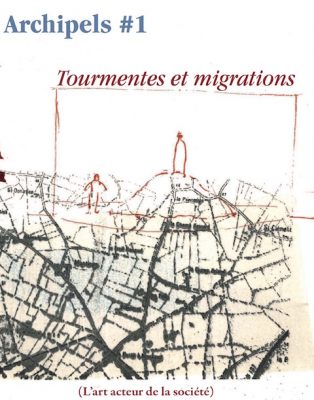
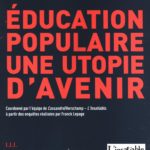
18.00€
Ajouter au panier




Certes, « communauté » est un mot de plus en plus difficile à employer dans notre société, tant il a été dévoyé par des usages politiciens. Pourtant au théâtre (en art en général), il signifie autre chose, une façon de se réunir bien plus grande, bien plus ouverte, bien plus universelle. Par exemple cette communauté aléatoire, comme le dit Peter Brook, de ceux qui se retrouvent par « hasard » dans un théâtre et partagent un geste artistique sur la base de codes qu’ils ont en commun. Cette communauté d’esprit qui nous permet de vivre les choses ensemble pour ouvrir le débat, c’est ce que crée l’art et c’est ce qui en fait la force.
La réflexion initiée par Olivier Neveux dans son important ouvrage Politiques du spectateur donne la matière d’un bel entretien en ouverture de ce numéro 95, qui propose par ailleurs de penser la fabrication du collectif, de l’agir ensemble, à travers des lieux, territoires et expériences qui permettent une observation fine d’artistes et de groupes soucieux de la participation active de spectateurs critiques. On y trouve, entre autres, un dossier spécial sur la et les culture(s) dans les pays d’Europe centrale, l’histoire et l’évolution du très vaillant Festival TransAmériques de Montréal et celles du remarquable Manifeste à Grande-Synthe, de l’incroyable et immense Festival des fromages de chèvres de Courzieu, une belle enquête sur le travail de la cinéaste Claire Simon, ainsi que l’actualité de l’Hestejada d’Uzeste – qu’on ne présente plus – et du magnifique Festival de cinéma de Douarnenez qui, cette année, célébrait les Rroms.
Xavier Marcheschi
Propos recueillis par Myriem Hajoui
Flibustier de la scène, franc-tireur patenté, libre penseur, figure totémique d’un département aux rêves piratés, bretteur infatigable des planches, Xavier Marcheschi a toujours préféré les habits de bure aux habits de lumière, l’aventure humaine à celle de la société-spectacle. Son credo : fouler au pieds les a priori parisianistes, ruiner les clichés qui vouent la banlieue aux gémonies du socio-culturel de pacotille et rabattre le caquet des aigrefins pour qui les pièces du répertoire ne sont pas accessibles aux exclus de la logique économique. Le reste n’étant que billeversées. Un visage travaillé au burin par le temps, des yeux laissant filtrer un regard qui jauge sans aménité, capable de passer de la fureur électrique à la bienveillance, cet artisan travaille inlassablement à rejoinder les spectateurs de la ville la plus pauvre du département.
Tandis que certains se lancent un brin amusés dans l’aventure dans l’aventure du théâtre socio-culturel façon folklore, il dresse un joyeux bilan (de 34 ans) au service du théâtre de proximité. Sans pathos ni prêchi-prêcha, il arrache la peau des apparences pour nous faire découvrir ce qui s’y tient caché : notre sauvagerie.
Cassandre : Xavier Marcheschi, racontez-nous votre arrivée au Studio Central de Stains…
Xavier Marcheschi : Tout a débuté par une préfiguration assez longue. J’ai toujours fonctionné comme ça ; je n’ai jamais été parachuté nulle part. J’ai besoin d’une longue approche, de bien connaître mon sujet avant de me lancer dans une aventure. Au début des années 60, tandis que je travaillais avec Jean Negroni à l’édification d’un grand théâtre populaire, je me suis retrouvé dans une cité de transit cernée par des clôtures à Créteil, au cœur d’une association d’aide aux délinquants. Une autre planète ! Ces pré-délinquants ou délinquants sortis de prison étaient désireux de participer à une activité mécanique. Cela fut fait. Mais parallèlement à l’atelier mécanique, j’ai proposé une activité théâtrale. Nous avons monté Le Commissaire est bon enfant de Courteline qui les a beaucoup amusés. Pensez, se payer la fiole des flics ! Cela dit, il s’agissait d’un veritable travail théâtral. J’étais déjà en pleine préfiguration. Arrivent les années 70, une collaboration de deux ans avec Jacques Lassalle à Vitry, mais aussi avec Claude Girard. Ce qui n ous intéressait alors, c’était le travail d’enquête auprès des gens, des jeunes, tout ce qui relevait de l’improvisation également. À ce moment-là, le lien avec la réalité passait par plusieurs subjectivités. Mais il s’agissait de la langue de Lassalle au fond. Ressentant de plus en plus le besoin d’aller en amont rencontrer les gens, j’ai décidé de rompre les amarres. Travailler avec Lassalle m’a certes enrichi, mais je crois sincèrement que tout ce que j’ai pu apprendre, je le dois avant tout à moi-même, comme tous les autodidactes. J’ai toujours pensé que des gens comme Lassalle étaient beaucoup trop enfermés dans leur culture, leur citadelle du savoir, et peu enclins au partage. Il faut resituer le contexte : c’était alors l’époque du metteur en scène gourou, de « l’acteur-marionnette ». Je passe sur une foultitude d’expériences, notamment au Théâtre Présent, pour arriver aux années 70 qui m’amènent à la direction de la Maison du Peuple de La Courneuve. Le travail de préfiguration à Stains se confirme vraiment là. Avec quatre comédiens, on a exploré toutes les voies possibles et imaginables, joué dans les cantines, les foyers, les salles de classe, avec toujours en ligne de mire le jeune public de La Courneuve. Une expérience formidable sur le terrain vraiment ! Début 80, en tant que directeur de l’Espace Paul Eluard, je poursuis ce contact quotidien avec le futur public en fréquentant les comités d’entreprise, les foyers de travailleurs, les églises, les entrepôts… Un jour de 1984, passant devant un vieux cinéma fermé, Le Central (tous les cinémas de Stains ayant été transformés en boulangeries industrielles ou en magasins d’électroménager), j’ai demandé l’autorisation d’en faire un lieu de création et de répétition. Un bail de longue durée fut signé. Nous l’avons mis en configuration, aménagé, ajouté notre mémoire, notre pratique, notre esthétique. Le Studio Central de Stains était né !
Un lieu oui, mais pour répondre à quels objectifs ?
L’arrivée au Studio n’est que le résultat d’un long cheminement, pas moins de vingt ans de travail sur la ville (bibliothèques, foyers, collèges … ). Mon seul désir était de rencontrer le public par la création. Commencer par la base pour arriver au sommet. Et ce ne fut pas chose aisée : nous étions, je le rappelle, dans l’ère du « tout créateur ». En fonction de la ville, du lieu où vous vous trouviez vous étiez un créateur ou rien. Je me suis aperçu que les gens que je pensais être des alliés ne l’étaient plus une fois arrivés dans l’institution. je me suis même entendu dire : « Pourquoi voulez-vous faire du théâtre à Stains puisqu’il y a Saint-Denis ? » Dès lors, j’ai compris le processus de démolition, de casse, des « dinosaures », des supermarchés qui ne supportent pas les petites boutiques et s’efforcent de les marginaliser. Peu importe ! Il y a une dichotomie violente entre le travail de certaines compagnies et cette situation monarchique. Chéreau déclarait un jour à qui voulait l’entendre : « Je veux que mes acteurs pètent dans de la soie. ». Nous travaillons avec Marjorie Nakache (depuis le début des années 80), dans les difficultés de la création, mais avec quel plaisir !

La danse des mots sur RFI du 12 janvier 2010
Extrait d’un article de David Langlois-Mallet publié dans l’hebdomadaire Politis :
« L’ambition la plus hardie du paysage de la critique culturelle. Là où tant de rubriques se résument à relayer la publicité – tant l’intention de leurs journalistes semble une injonction : « Achetez… » – ou à entretenir le savant mystère de la supériorité distinguée du rédacteur, Cassandre s’adresse à ceux des lecteurs qui ne veulent pas de réponses prêtes en 5 minutes au micro-ondes à des questions telles que : « Que « faut-il » voir cette semaine ? », « De quel film parle-t-on ? », « Qu’écoute-t-on ? », etc. Bref, comment alimenter la consommation culturelle mainstream vers les bacs de la Fnac la plus proche.
Cassandre, en un sens anti-Télérama, renverse la question culturelle par une question politique. La revue se demande où et comment les questions qui agitent notre société rencontrent un art vivant d’aujourd’hui. Un art exigeant, qui sache nous troubler, faire sens, réactiver en nous des valeurs intemporelles de notre humanité. Mais la revue, à l’heure du triomphe des hypermarchés culturels et des clubs privés, ne se limite pas à un guide des petites épiceries fines ouvertes la nuit pour les heureux consommateurs d’art bio. Cassandre entend donner des repères, dans une société où les intérêts privés les confisquent, pour jalonner notre propre aventure culturelle et politique.
Elle débusque bien sûr les endroits où « ça » se passe, ces points de contact (troupes, lieux, artistes, penseurs, …) entre l’exigence artistique et le désir d’humanité, autrement dit un art politique. Mais surtout elle en explore les processus avec l’ambition de doter le lecteur d’un solide bagage.
Une ambition non usurpée d’être une école de pensée critique à l’aune de notre exception culturelle française dont elle pose la critique radicale : « Un système de relations marchandes et/ou pseudo-élitistes ne nous laisse d’autre choix que d’être clients, initiés ou exclus », fusille plutôt qu’il n’écrit Nicolas Roméas, le directeur de la revue, en introduction à l’ouvrage de référence 1995-2005, 10 ans d’action artistique.
Une petite lumière, lampe-tempête, qui porte loin « un art préoccupé de son temps, qui recrée artistiquement dans l’instant où il est vécu la communauté humaine actuelle et immémoriale, la vraie, celle à laquelle j’appartiens », écrit Roméas…
« celle des tragédiens et celle des slammers. » »
David Langlois-Mallet, Politis n°891, 2 mars 2006.